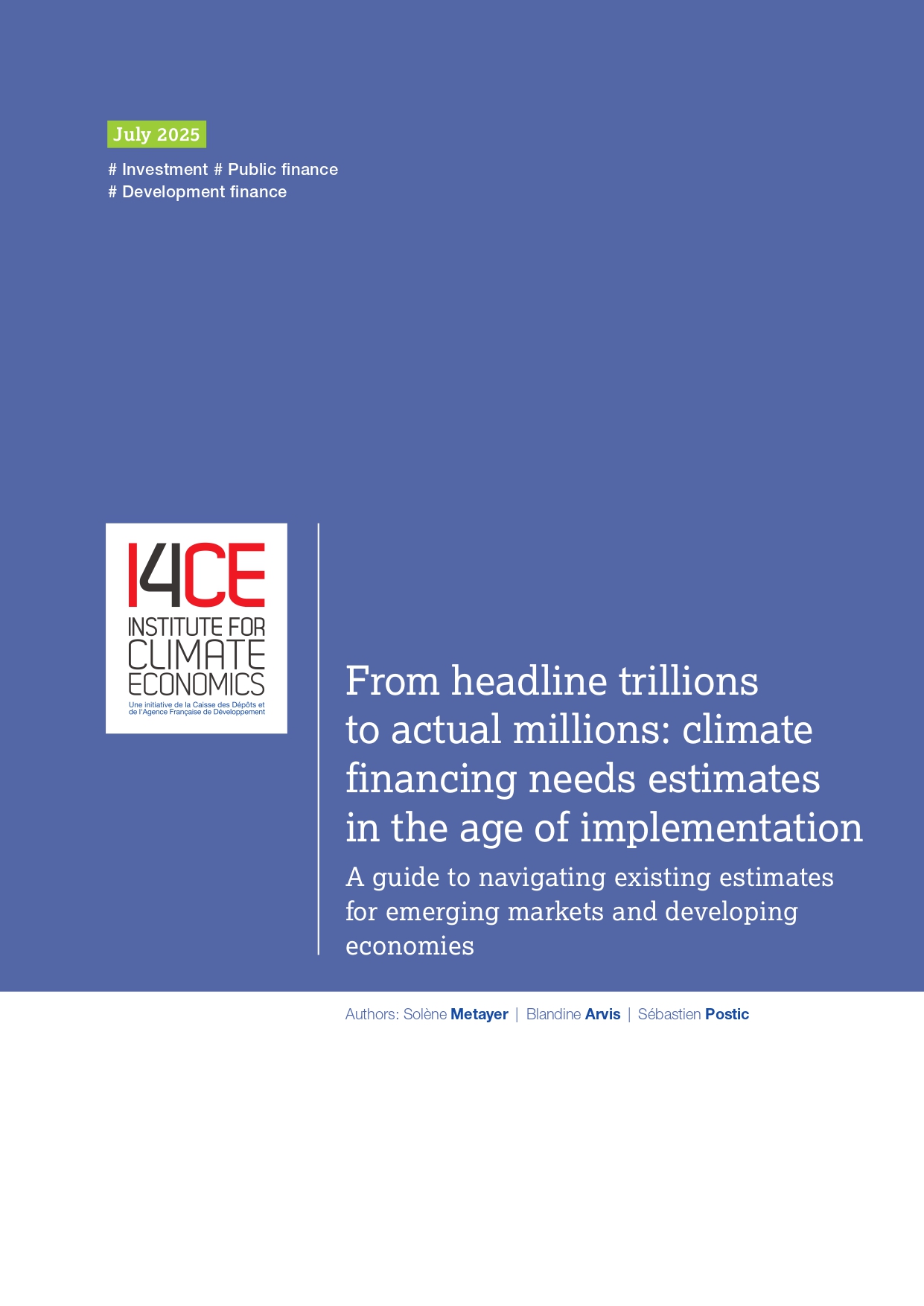De l’ambition à l’action : les estimations des besoins de financement à l’ère de la mise en œuvre
Rapport uniquement disponible en anglais
Un guide pour naviguer dans les estimations existantes pour les marchés émergents et les économies en développement
L’engagement pris de longue date par les pays développés de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour soutenir la lutte contre le changement climatique dans les pays en développement a été atteint en 2022. Malheureusement, cet objectif décidé en 2009 ne reflète plus l’ampleur de l’action aujourd’hui requise. L’adoption d’un Nouvel Objectif Collectif Quantifié (NCQG pour son sigle anglais : New Collective Quantified Goal) lors de la COP29 en novembre 2024 a constitué une étape politique majeure dans le renouvellement de cette ambition. Elle n’a toutefois pas permis de trancher les principales questions opérationnelles.
L’attention se déplace donc maintenant de l’élévation de l’ambition vers la mise en œuvre concrète de ces objectifs. Dans ce cadre, ce rapport propose une analyse critique des méthodes et discours qui sous-tendent les estimations actuelles des besoins de financement climatique. Il s’agit de mieux comprendre leur pertinence dans ce nouveau contexte. Nous nous interrogeons sur ce que ces chiffres représentent, sur leur mode de construction, leur potentiel pour orienter l’action dans les années à venir, ainsi que sur les améliorations prioritaires à apporter.
Au cœur de cette analyse se trouve le troisième rapport du Groupe d’experts indépendants de haut niveau sur le financement climatique (Independent High-Level Expert Group on Climate Finance, IHLEG), intitulé Raising Ambition and Accelerating Delivery of Climate Finance (Bhattacharya et al., 2024).
Lancé par les présidences des COP26 et COP27, l’IHLEG a régulièrement produit des estimations des besoins de financement nécessaires pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris, et des moyens d’y répondre. Son dernier rapport, publié en novembre 2024, évalue à 2 400 milliards USD par an d’ici 2030, et à 3 300 milliards d’ici 2035, les besoins de financement climatique des pays en développement (EMDE – hors Chine). Il propose également une répartition indicative de cette charge entre différentes sources de financement. Sa portée est ambitieuse : au-delà de la transition énergétique et de l’adaptation, il intègre les pertes et préjudices, le capital naturel ainsi que les dépenses liées à une transition juste. Ses estimations reposent sur des sources diverses, fondées sur des hypothèses, calendriers et périmètres sectoriels hétérogènes.
Le rapport de l’IHLEG illustre à la fois l’ambition et les limites des approches méthodologiques existantes Il couvre les cinq piliers de l’action climatique, et fournit une ventilation détaillée des sources et des usages des financements. Cependant, les données qui le sous-tendent restent fragmentées, parfois incohérentes, notamment en dehors du secteur des énergies propres. Même des concepts fondamentaux tels que la notion même de « besoin de financement » font encore l’objet d’interprétations divergentes.
En analysant les chiffres de l’IHLEG et en les replaçant dans le contexte plus large des estimations existantes, ce rapport montre que les montants souvent évoqués dans les forums internationaux masquent de profondes différences de périmètre, d’ambition et de méthode. Sans compréhension claire des hypothèses sous-jacentes, ces chiffres risquent d’induire en erreur plutôt que d’informer les discussions. Les estimations peuvent varier d’un ordre de grandeur selon qu’elles incluent ou non la Chine dans les EMDE, intègrent ou non le coût du capital, qu’elles se limitent à l’atténuation ou englobent aussi l’adaptation, les pertes et dommages et d’autres secteurs transversaux. Chacune d’elles repose sur des hypothèses spécifiques : rythme et intensité de l’action climatique, coût du capital dans les pays en développement, part respective des financements publics et privés. Ces choix sont rarement explicites, mais influencent profondément les chiffres clés et les récits qui les accompagnent.
Ce rapport met ainsi en lumière plusieurs leviers essentiels pour améliorer les estimations et renforcer leur utilité :
- Premièrement, les estimations agrégées doivent être rendues plus cohérentes ou, à défaut, plus lisibles, en s’appuyant sur des cadres cohérents déjà existants.
- Deuxièmement, l’ambiguïté persistante autour de l’additionnalité du financement climatique doit être levée, pour que les discussions internationales s’appuient sur une grammaire commune et bien comprise par tous : en distinguant par exemple investissements de développement alignés et spécifiques au climat, ou coûts marginaux et coûts totaux. Aujourd’hui, les estimations varient fortement selon ces choix, souvent amalgamés sans distinction claire dans un même rapport.
- Troisièmement, et c’est peut-être le point le plus crucial , il est temps de passer de l’estimation abstraite des besoins à la formulation de stratégies de financement concrètes. Cela implique intégrer les principaux déterminants de calcul du coût du capital et de préciser les sources et instruments mobilisables, avec leurs contraintes propres, pour les acteurs publics comme privés.
Cependant, les décideurs ne peuvent se permettre d’attendre une compréhension parfaite pour commencer à agir (et ne l’ont pas fait). Les estimations agrégées existantes, aussi imparfaites soient-elles, ont joué un rôle déterminant pour fixer les ordres de grandeur de l’action climatique à mener. Leur amélioration prendra du temps. La communauté scientifique doit donc continuer à s’atteler à ces questions de robustesse, mais les chercheurs et décideurs doivent, dès à présent, tirer le meilleur parti des données disponibles pour guider l’action. Cela suppose de :
- Reconnaître que des scénarios d’atténuation et d’adaptation incohérents, combinés à des données de mauvaise qualité, continueront d’entraver la production d’estimations fiables des besoins de financement climatique, et considérer ces chiffres uniquement comme des indications générales de la direction à prendre. Leur véritable valeur réside dans le fait qu’ils permettent de cadrer la compréhension collective et d’aligner les attentes.
- Se concentrer sur ce que ces estimations peuvent nous apprendre d’autre : quels acteurs doivent être mobilisés, quels instruments privilégiés, quelles hypothèses sont faites sur la coopération internationale, les effets de levier, ou les conditions de déclenchement de l’investissement – et comment ces éléments peuvent être opérationnalisés.
- Identifier les points de divergence les plus marqués entre scénarios de mobilisation, et comment les concilier dans une proposition ambitieuse mais réaliste. À ce titre, les différences de vues entre l’IHLEG et les signataires du NCQG sur la mobilisation des financements privés méritent un examen approfondi.
- Travailler avec des fourchettes d’incertitude, dont les bornes sont souvent plus faciles à expliquer et débattre que des estimations centrales trompeusement précises. Par exemple, le chiffre unique avancé par l’IHLEG pour les besoins d’adaptation est moins informatif que les deux valeurs d’origine avancées par le Adaptation Gap Report du PNUE.
À mesure que les discussions évoluent du cadrage politique à la mise en œuvre concrète, le succès ne dépendra pas tant de la précision des estimations que de notre capacité collective à traduire les ambitions en stratégies de financement crédibles, inclusives et réalisables. Des trillions affichés aux millions effectivement mobilisés, le véritable défi n’est pas tant d’estimer l’écart que de trouver les voies pour le combler.