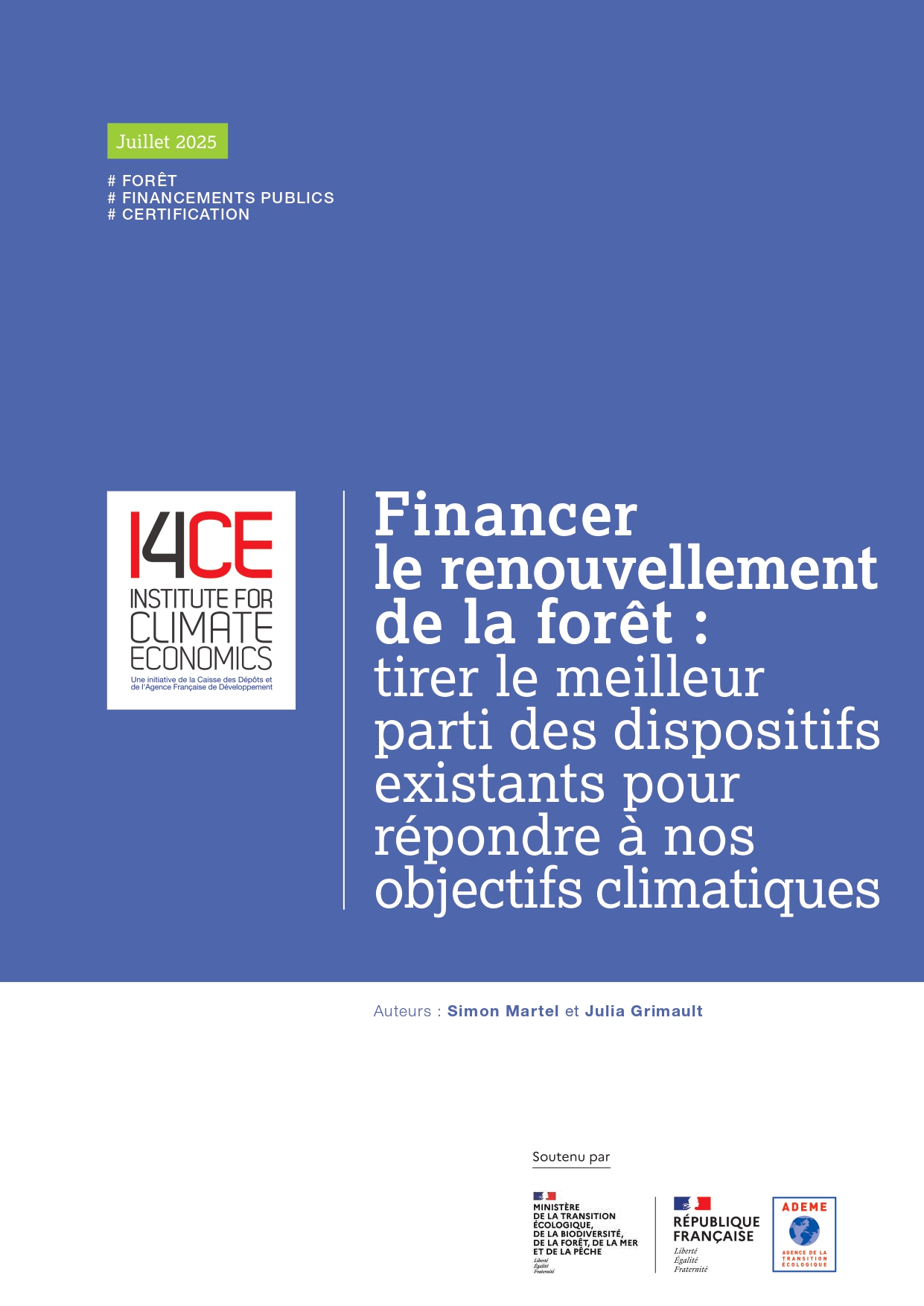Financer le renouvellement de la forêt : tirer le meilleur parti des dispositifs existants pour répondre à nos objectifs climatiques
Les services de puits de carbone, de fourniture de matériaux bois et d’énergie rendus par la forêt française sont indispensables pour atteindre la neutralité carbone en 2050 en France, mais ils sont menacés par les impacts du changement climatique. Le secteur forestier nécessite donc des moyens pour adapter la forêt et garantir son rôle d’atténuation du changement climatique. Aujourd’hui, deux principaux dispositifs financent le renouvellement des forêts françaises :
- les fonds publics destinés au renouvellement forestier, matérialisés par 3 plans successifs sous l’égide du plan de relance (2021- 2023), de France 2030 (2023-2024) et plus récemment de France Nation Verte (à partir de novembre 2024) ;
- le label Bas-Carbone (LBC) qui mobilise essentiellement des financements privés depuis 2019.
Ces dispositifs ont mobilisé ces dernières années de l’ordre de 300 M€ pour réaliser 78 000 ha de plantation. Ce sont des sommes sans précédents depuis plusieurs décennies, mais cela reste bien en deçà des efforts nécessaires, chiffrés à 1,5 Mha en 10 ans*. Par ailleurs, le contexte actuel de renforcement de la contrainte budgétaire appelle une vigilance accrue sur la préservation des moyens humains et financiers liés à l’adaptation des forêts mais aussi à une attention particulière sur l’efficacité et l’efficience de ces dépenses, notamment vis-à-vis du climat.
Cette étude propose ainsi une analyse des cahiers des charges des deux dispositifs, afin de les comparer et d’apporter un éclairage sur leur contribution aux enjeux climatiques. Des pistes de complémentarités sont aussi évoquées dans la mesure où ils ciblent partiellement les mêmes forêts : celles touchées par un incendie ou des dépérissements intenses.
Nous constatons tout d’abord une amélioration au fil des années des cahiers des charges des deux dispositifs, qui ont aujourd’hui convergé sur de nombreux critères : si ces derniers restent perfectibles, l’intégrité environnementale s’est globalement renforcée, par exemple en intégrant des seuils pour la diversification des essences et en tenant compte de leur adaptation aux conditions futures. Les modes d’interventions financés sont également plus nombreux, ce qui est essentiel dans un domaine où aucune solution unique n’existe, même s’ils ont pour l’instant du mal à se traduire sur le terrain.
En revanche, alors que le LBC est conçu par nature pour cibler des actions dont l’impact climatique est bénéfique à horizon 2050, ce n’est pas toujours le cas pour les financements publics, qui impliquent parfois un bénéfice carbone lointain. Certaines actions financées, comme la reconstitution de peuplements « pauvres », auront en effet un impact carbone négatif à court terme et ne seront vraisemblablement bénéfiques qu’au terme de plusieurs décennies. De même, certaines opérations de reboisement peuvent entraîner des émissions de carbone du sol qui ne sont aujourd’hui pas prises en compte. Dans une logique d’efficacité de la dépense publique, nous recommandons donc de mieux prioriser les actions sans regrets du point de vue du climat, en ciblant prioritairement les peuplements fortement dégradés par les crises sanitaires, tout en renforçant les exigences visant à préserver le carbone des sols. Le LBC peut servir d’inspiration sur ces points.
Enfin, améliorer l’articulation des deux dispositifs en poursuivant la convergence des cahiers des charges et en facilitant le co-financement des projets présenterait des bénéfices réciproques :
- améliorer l’efficience des dépenses publiques, en permettant de restaurer une plus grande superficie pour un même montant d’argent public, tout en garantissant un impact climatique positif d’ici 2050 d’une part ;
- soutenir le développement et l’amélioration des projets LBC dans un contexte concurrentiel d’autre part.
*D’après le rapport « Objectif Forêt » publié en juillet 2023